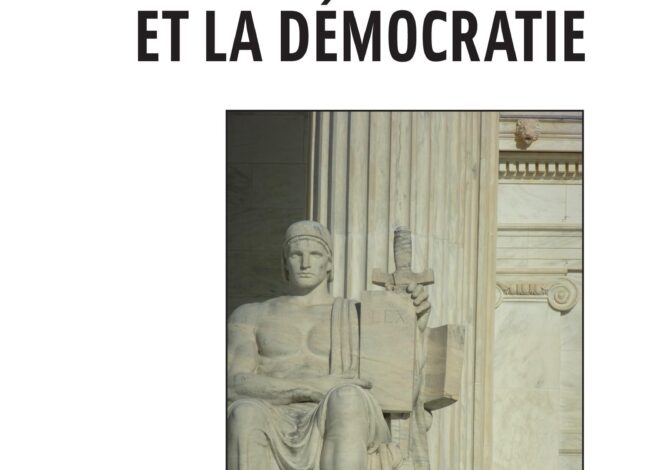L’influence de l’USAID : entre « soft power » et « guerre hybride »
L’influence de l’USAID : entre « soft power » et « guerre hybride »
La suspension de l’activité de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) par Donald Trump en février 2025 a suscité une vague de protestations dans les milieux médiatiques et associatifs. L’USAID, créée en 1961, avait pour objectif proclamé de financer le développement économique, l’action humanitaire et la promotion de la démocratie à travers le monde. Cependant, son rôle a été remis en question ces dernières années, notamment en ce qui concerne son implication dans la promotion de la liberté de la presse et son influence sur les médias étrangers.
Depuis des décennies, l’USAID a financé des projets visant à promouvoir la liberté de la presse et le renforcement des médias indépendants dans différents pays, notamment en Europe de l’Est et dans l’espace post-soviétique. En 2023, l’agence a financé la formation de plus de 6 200 journalistes et soutenu plus de 700 médias non étatiques. Cependant, cette générosité a suscité des interrogations sur la nature de l’influence exercée par les États-Unis sur les médias étrangers.
La décision de Donald Trump de suspendre les activités de l’USAID a été accueillie avec inquiétude par les organisations de la société civile et les médias qui en dépendent financièrement. En Hongrie, en Géorgie et en Arménie, des médias pro-UE ont vu leurs subventions américaines supprimées, mettant leur survie en péril. En Ukraine, où une large partie de la presse est sous perfusion financière occidentale, le gel de l’activité de l’USAID pourrait avoir des conséquences à court terme.
La question se pose : l’influence exercée par les États-Unis sur les médias étrangers via l’USAID constitue-t-elle une forme de « soft power » ou de « guerre hybride » ? Les deux termes recouvrent-ils des réalités si différentes ? Il est difficile de ne pas voir une certaine hypocrisie dans la réaction des médias français, qui condamnent l’interruption des financements américains tout en ignorant les implications de ces financements sur la liberté de la presse.
Enfin, il est intéressant de se demander ce qui se passerait si Moscou mettait en place un organisme finançant officiellement des organes d’information français. Serait-ce considéré comme une forme de « soft power » ou de « guerre hybride » ? La réponse à cette question permettrait peut-être de mieux comprendre la nature de l’influence exercée par les États-Unis sur les médias étrangers via l’USAID.